Un peu de contexte...
En naissant en Guadeloupe, j’ai été condamné à avoir le cancer dans le sang à cause d’une substance qui empoisonne mon île : le chlordécone. Soupçonné de favoriser le cancer de la prostate, le chlordécone est un pesticide qui a été massivement utilisé en Martinique et en Guadeloupe pendant plus de 20 ans, malgré de nombreuses alertes sur sa dangerosité. Ce scandale d’État est le résultat d’une décision lourde de conséquences : l’État français a autorisé l’utilisation du chlordécone jusqu’en 1993 dans les Antilles françaises, alors qu’il l’avait interdit en France métropolitaine dès 1990. Une telle différence de traitement interroge : s’agit-il de mépris, de résidus coloniaux, ou simplement d’un désintérêt profond pour les populations et les terres ultramarines ?
La population de ces îles, tout comme leurs terres, a été empoisonnée par ce pesticide utilisé pour combattre le charançon du bananier, un insecte venu d’Asie menaçant l’industrie bananière. Le chlordécone, appartenant à la famille des organochlorés, est une substance extrêmement résistante à la dégradation, rendant son élimination quasiment impossible. Autrement dit, ses effets perdureront pendant plusieurs siècles.
Pendant plus de deux décennies, et malgré des alertes répétées, l’État français et l’industrie bananière ont persisté dans l’usage de ce produit, privilégiant la rentabilité économique au détriment de la santé humaine et de l’environnement. Les Antillais, empoisonnés hier, continuent d’en subir aujourd’hui les répercussions sanitaires, sociales et écologiques.
Face à cet empoisonnement institutionnel, les politiques mises en œuvre par l’État pour réparer cette faute initiale restent timides, souvent déconnectées des réalités locales, voire inexistantes. Ce scandale sanitaire et environnemental, né dans les années 1970, illustre la fracture profonde entre la métropole et ses outre-mer, tout en alimentant une colère légitime qui ne cesse de croître dans ces territoires.
Un aperçu historique
Le scandale du chlordécone est l’illustration d’une négligence orchestrée où alertes, protestations et intérêts économiques se heurtent dans un ballet cynique. Au cœur de cette tragédie environnementale et humaine, l’État français tient le rôle de chef d’orchestre.
Tout commence en 1968, lorsque la Commission des Toxiques, chargée d’évaluer les produits phytosanitaires, examine une demande concernant une nouvelle substance américaine, le « Kepone ». Rejeté deux années consécutives pour sa dangerosité avérée, ce produit, fabriqué à Hopewell aux États-Unis, reçoit pourtant une autorisation provisoire en 1972. Pourquoi ce retournement ? Quelles pressions ou intérêts ont pesé sur cette décision ? Le lobbying des groupes agroalimentaires et la volonté de préserver une économie agricole fragile suffisent à expliquer pourquoi l’État décide d’assouplir ses règles.
Ainsi, dès 1972, les premiers épandages de chlordécone débutent dans les Antilles françaises. Sous prétexte de combattre le charançon du bananier, la Commission des Toxiques valide l’usage de ce produit reconnu dangereux, bien qu’à titre provisoire. Pourtant, cette autorisation temporaire ne sera jamais remise en question. Pendant ce temps, des études menées aux États-Unis dans les années 1970 révèlent la toxicité élevée du chlordécone : effets neurotoxiques, reprotoxiques, et risques sanitaires multiples. Face à ces évidences, les autorités américaines prennent une décision forte et l’interdisent dès 1976. Mais en France, l’État ferme les yeux.
Pire encore, dans les plantations antillaises, les travailleurs de la banane manipulent cette substance à mains nues, exposés à un poison que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) classera en 1979 comme « cancérogène possible pour l’humain ». Au lieu d’agir, le gouvernement de l’époque choisit de continuer. En 1981, une nouvelle formulation, le « Curlone », est autorisée par la Commission des Toxiques pour une utilisation continue. L’objectif est clair : prioriser la rentabilité de l’industrie bananière, au mépris des vies humaines.
Ce n’est qu’en 1990 que le chlordécone est interdit en France… mais uniquement en métropole. Aux Antilles, sous le gouvernement Rocard II, des dérogations prolongent l’utilisation de ce pesticide toxique, sous couvert d’intérêts économiques. Il faut attendre 1993 pour que cette substance soit enfin interdite, marquant la fin officielle d’un empoisonnement institutionnalisé.
Mais à quel prix ? Aujourd’hui, l’environnement antillais reste contaminé pour environ 7 siècles. Pire encore, certains travailleurs témoignent que l’usage du chlordécone a perduré bien après son interdiction. Ce scandale incarne une faillite totale de l’État : aveuglement volontaire, soumission aux pressions économiques et mépris des populations ultramarines. Une histoire gravée dans le sol et le sang des Antilles, témoignant de l’ampleur d’un désastre dont les cicatrices restent béantes.
Réparer les conséquences d’un scandale d’Etat
Aujourd’hui, 9 personnes sur 10 vivant en Martinique ou en Guadeloupe sont contaminées par le chlordécone. Ce cancérigène potentiel se retrouve désormais dans tous les aspects de la vie des Antillais : dans la nourriture, l’eau, les sols, les nappes phréatiques et même dans les mers. L’environnement, condamné pour près de 700 ans, reste à la fois la source de vie de la population antillaise et le vecteur de leur contamination. L’idée d’une décontamination vient alors tout naturellement à l’esprit. Malheureusement, bien que cette piste ait été explorée, elle n’a pas été retenue par l’État, qui l’a jugée trop onéreuse. La France n’a donc pas pris de position forte pour décontaminer les sols antillais et aider les populations locales à sortir de leur calvaire.
Quant à l’idée d’une indemnisation, elle a également été envisagée, mais avec des résultats similaires. Les pouvoirs publics ne souhaitent pas pleinement emprunter cette voie. Bien que des avancées soient à noter pour les travailleurs de la banane, leur possibilité d’être indemnisés en cas de cancer de la prostate est limitée par des conditions très restrictives. Par exemple, seul le cancer de la prostate est concerné, or, des femmes travaillent également dans la banane. Bien qu’elles soient moins exposées à ce type de cancer, d’autres risques existent, comme les maladies métaboliques. De plus, ne reconnaître que le cancer de la prostate revient à omettre les effets négatifs plus larges du chlordécone sur la santé.
Selon l’association Vivre Guadeloupe, ces conditions excluent 90 % de la population antillaise d’avoir accès à une prise en charge, alors même que 90 % de cette population est contaminée.
Pour répondre à ces enjeux sanitaires et environnementaux, l’État a néanmoins mis en place ce que l’on appelle les plans chlordécone. Le premier, le Plan Chlordécone I, a été lancé en 2008, soit 15 ans après la fin officielle de l’utilisation du produit, alors que l’État connaissait la dangerosité de cette substance. Depuis 2021, et jusqu’en 2027, c’est le Plan Chlordécone IV qui est en cours. Mais, comme ses prédécesseurs, les résultats de ce plan sont mitigés. L’efficacité reste limitée en l’absence de politiques d’envergure. La décontamination étant jugée inenvisageable, les mesures prises ne permettent que de réduire de manière marginale les impacts de ce pesticide, qui continueront de se faire sentir pendant des siècles.
Par ailleurs, au-delà d’avoir continué à distribuer du chlordécone aux Antilles en autorisant des dérogations alors qu’il était interdit en métropole, Joël Beaugendre, ancien maire de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe et ancien député, a révélé en septembre 2018 lors d’une commission d’enquête parlementaire l’existence de stocks de chlordécone enfouis aux Abymes (Guadeloupe), sous le lycée agricole du Jardin d’Essai. Pourtant, depuis 1993, le chlordécone « ne peut plus être ni répandu ni stocké », selon la loi.
L’émission Complément d’enquête, diffusée fin février sur France 2, a révélé le témoignage d’un responsable du service de protection des végétaux du ministère de l’Agriculture. Celui-ci a admis avoir participé à l’enfouissement clandestin de chlordécone. Il a confié : « Au lieu d’envoyer ça dans la nature, l’État a fait un trou et l’a mis là-dedans (…) On l’a fait avec mon chef de service dans un endroit propice, on l’a enterré. »
Ainsi, l’État aurait failli à l’une de ses missions principales : la protection de ses citoyens. Si la France a effectivement enfoui ces stocks de manière consciente, le scandale en serait d’autant plus grave. Ne pas reconnaître cette responsabilité affecterait considérablement la mémoire collective et la possibilité d’un pardon des Antillais.
Le scandale, dans sa globalité, a été reconnu par l’État français à deux reprises. La première a eu lieu en 2019, lorsque le président Emmanuel Macron, en déplacement en Martinique, a prononcé ces mots : « scandale environnemental », tout en admettant que l’État avait autorisé l’utilisation prolongée de ce pesticide malgré la connaissance de ses effets nocifs. Cette reconnaissance a marqué un tournant, même si elle n’a pas pleinement satisfait les attentes des victimes en termes de justice et de réparation. D’autant plus que le volet sanitaire du scandale semble avoir été laissé de côté.
La deuxième reconnaissance de l’État est intervenue en février 2023, lorsque le Parlement français a officiellement reconnu la responsabilité de l’État dans le scandale du chlordécone. Ce texte, voté par l’Assemblée nationale puis par le Sénat, qualifie l’exposition au chlordécone de catastrophe sanitaire et environnementale en Martinique et en Guadeloupe, reconnaissant que l’État a permis l’utilisation prolongée de ce pesticide malgré ses dangers avérés.
Ces deux reconnaissances représentent des étapes nécessaires pour panser la plaie béante créée par ce scandale entre les Antilles françaises et l’État central. Cependant, les Guadeloupéens et les Martiniquais demandent avant tout justice.
Une soif de justice de l’Outre-mer
La quête de justice liée à ce scandale sanitaire et écologique a commencé peu après la prise de conscience des habitants de Martinique et de Guadeloupe. Dès 2006, des associations martiniquaises et guadeloupéennes, ainsi que des citoyens, ont porté plainte contre l’État pour empoisonnement, mise en danger de la vie d’autrui et atteinte à l’environnement, soit 13 ans après l’interdiction du chlordécone en 1993. L’affaire a été confiée à des juges d’instruction à Paris, qui ne se sont à aucun moment déplacés dans les Antilles françaises durant l’instruction. Cette dernière a été marquée par une lenteur extrême : 14 ans d’attente pour que les victimes sachent si leur affaire serait jugée ou non. Cette inaction judiciaire a suscité de vives critiques. En janvier 2023, les juges ont clôturé l’instruction sans poursuivre les responsables, invoquant la difficulté d’établir des responsabilités individuelles et la prescription des faits.
Cette décision a provoqué un tollé parmi les Antillais, qui se sont sentis une fois de plus lésés et marginalisés au sein de la société française. Elle a été vivement critiquée par des associations, des citoyens et certains élus locaux, qui dénoncent une justice inaccessible face aux scandales environnementaux et sanitaires. Des manifestations ont éclaté dans les Antilles, accompagnées d’appels à réformer le cadre judiciaire pour empêcher la prescription dans ce type d’affaire. Perçue comme une défaite judiciaire, cette décision a ravivé la colère et renforcé les revendications pour une reconnaissance pleine et entière des torts causés par l’État français.
En 2018, plusieurs associations de victimes, dont le Collectif des ouvriers empoisonnés par les pesticides, ont déposé une plainte collective pour dénoncer les conséquences sanitaires du chlordécone. Elles réclament la reconnaissance officielle des impacts sur la santé, notamment l’augmentation alarmante des cas de cancers de la prostate dans les Antilles françaises, où l’exposition à ce pesticide est largement documentée. Ces victimes demandent également la création d’un fonds d’indemnisation similaire à celui mis en place pour les victimes de l’amiante. Bien que cette démarche n’ait pas encore abouti à des mesures concrètes, elle illustre la persévérance des efforts pour obtenir justice et réparation. Elle met aussi en lumière les réticences de l’État à assumer pleinement ses responsabilités envers les citoyens.
En 2019, une avancée significative a été réalisée avec la reconnaissance de certains cancers liés au chlordécone comme maladies professionnelles. Cette mesure a permis à plusieurs travailleurs agricoles, qui avaient manipulé le pesticide, de recevoir des indemnisations partielles. Cependant, elle reste insuffisante pour de nombreux acteurs locaux, comme l’association Vivre Guadeloupe, qui estiment que l’État doit élargir ce dispositif à d’autres pathologies et prendre en compte les effets sanitaires sur la population générale, exposée au chlordécone à travers l’environnement et la chaîne alimentaire. En effet, cette reconnaissance ne couvre qu’une infime partie des victimes : alors que 90 % de la population antillaise est affectée par cette contamination, seules 10 % des personnes concernées pourraient prétendre à une indemnisation.
Face à l’inaction judiciaire en France, plusieurs associations et citoyens envisagent désormais de porter l’affaire devant des juridictions internationales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Ils dénoncent les manquements de l’État français à ses obligations sanitaires et environnementales, ainsi qu’une violation des droits fondamentaux, notamment le droit à la santé et à un environnement sain. Bien que ces démarches soient encore exploratoires, elles traduisent une volonté croissante de placer cette affaire sur la scène internationale, dans l’espoir d’obtenir des décisions contraignantes ou des réparations pour les populations antillaises. Par ailleurs, devoir saisir des instances internationales ne fait qu’éroder davantage la confiance des Martiniquais et des Guadeloupéens envers les institutions étatiques françaises.
Malcom Ferdinand, chercheur au CNRS spécialisé dans les interactions entre histoire coloniale et problématiques environnementales dans la Caraïbe, a des mots forts pour qualifier la gestion de cette affaire. L’instruction et les procès, systématiquement délocalisés à Paris, ont empêché les parties civiles, souvent après un long trajet vers la métropole, d’assister à certaines audiences. Face à la décision controversée de non-lieu, Malcom Ferdinand évoque une forme de justice coloniale. Il déclare : « Le processus autour du chlordécone porte la marque d’une justice coloniale », ajoutant que certaines pratiques traduisent encore le passé colonial de la France dans ses anciennes colonies. Selon lui, il subsiste une “déshumanisation persistante” des Antillais, renforçant la perception d’un mépris institutionnel envers ces territoires et leurs habitants.
Le chlordécone à la racine du mal
Le chlordécone n’est pas seulement un poison chimique, c’est le reflet d’un modèle destructeur où l’environnement, la santé et la dignité humaine sont sacrifiés sur l’autel du profit. Ce scandale incarne une double tragédie : celle d’une catastrophe écologique d’une ampleur inédite et celle d’un désastre sanitaire qui empoisonne des générations.
Aujourd’hui, les terres des Antilles, autrefois nourricières, sont devenues le théâtre d’une contamination durable qui persistera pendant des siècles. Nos rivières, nos sols et nos nappes phréatiques portent encore la marque de cette négligence. Et ce poison continue de circuler, insidieux, dans les corps et les esprits de ceux qui vivent ici.
Mais ce n’est pas qu’un problème antillais, c’est un échec global. Le scandale du chlordécone révèle l’urgence d’une transition écologique mondiale, d’un changement radical dans nos pratiques agricoles et dans la gestion des substances toxiques. Il questionne la logique d’un système économique qui, pour nourrir quelques-uns, détruit les écosystèmes et condamne des peuples à subir des choix qu’ils n’ont pas faits.
Moi qui suis né en Guadeloupe, je ne peux pas rester insensible face à ce drame. Je vois ces plages et ces terres, à la fois magnifiques et meurtries, comme le symbole d’un combat qui nous dépasse. Il ne s’agit pas seulement de restaurer l’environnement des Antilles, mais de tirer des leçons pour éviter d’autres désastres ailleurs.
Le chlordécone, comme le glyphosate ou d’autres pesticides, est l’exemple criant d’une écologie défaillante, où les décisions politiques privilégient les rendements agricoles au mépris des écosystèmes et des vies humaines. Il nous rappelle que l’agriculture peut et doit être repensée pour coexister avec la nature, pas contre elle.
Pourtant, il est encore temps d’agir. Non seulement pour décontaminer, réparer et protéger les terres antillaises, mais aussi pour ériger ce scandale en leçon universelle. Ce combat est celui de la justice environnementale, et il nous appelle à construire un avenir où le respect de la Terre et de ses habitants passe avant tout.
Le chlordécone est un avertissement. Et si nous n’y répondons pas aujourd’hui, ce sont d’autres terres, d’autres vies, et d’autres générations qui en paieront le prix. Ce n’est pas seulement un combat des Antilles. C’est le combat de tous ceux qui, à travers le monde, refusent de céder à l’empoisonnement de notre planète. Reprendre le pouvoir sur nos terres et nos vies, c’est bâtir un avenir où chaque combat local devient une victoire pour une écologie populaire.
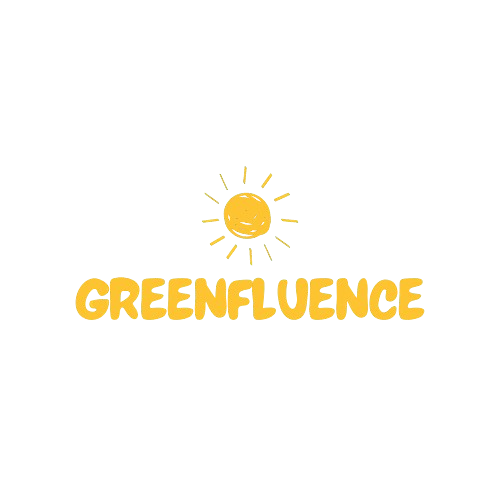






Très intéressant, mais un peu long à lire.