Saviez-vous qu’il faut 2 700 litres d’eau pour produire un simple tee-shirt, soit l’équivalent de ce qu’une personne boit en deux ans et demi ? Ce chiffre frappant, révélé par Greenpeace France, illustre l’impact considérable de l’industrie textile sur l’environnement. Responsable de 10 % des émissions mondiales de CO2, elle rivalise avec le transport aérien et maritime réunis en termes de pollution.
Cette industrie est donc une des plus polluantes au monde, son impact étant exacerbé avec l’essor de la fast-fashion notamment depuis le début du 21ème siècle. Ce phénomène s’est ancré dans nos quotidiens et s’appuie sur un renouvellement ultra-rapide des collections de mode dans un objectif de rentabilité accrue qui aurait rapidement conquis la plupart des grandes entreprises textiles. Ce système repose sur des cycles de production courts et intensifs, une délocalisation dans des pays à faible coût de main-d’œuvre, et une incitation à l’achat fréquent grâce à des collections renouvelées en permanence. Bien qu’elle permette de rendre la mode accessible au plus grand nombre, elle soulève des préoccupations majeures en matière d’impact environnemental et social.
La fast fashion, un fléau pour l’environnement
Il est évident que nous avons tous déjà acheté ce jean bon marché proposé par une grande marque spécialisée dans la production de masse. Mais s’est-on demandé ce qu’il se passe réellement derrière l’achat de ce jean ?
Les impacts environnementaux liés à la fast fashion sont multiples. La production d’un vêtement et notamment d’un jean consomme énormément d’eau puisqu’ il faut en moyenne, selon l’Ademe, l’équivalent de 285 douches pour fabriquer un jean soit 9000 litres d’eau. Ce chiffre saisissant invite à reconsidérer la notion de sobriété, entendue comme un effort individuel de modération visant à réduire les pressions environnementales. Il souligne la nécessité de diminuer notre consommation personnelle de vêtements afin de lutter efficacement contre la surconsommation.
La filière du textile est donc une des plus consommatrices en eau qui est utilisée dans plusieurs étapes de la fabrication comme l’obtention des matières premières, les transformations industrielles ou encore le lavage.
En effet, un article publié en 2020 par le site officiel du Parlement européen alertait sur le fait que le secteur textile était la troisième plus grande source de dégradation de l’eau et d’utilisation des terres en 2020. L’utilisation du coton par exemple représente 24% des matières premières choisies selon l’Ademe, cependant elle est l’une des cultures les plus consommatrices d’eau au monde. Ce n’est pas tout, celle-ci nécessite aussi l’usage de pesticides nocifs pour l’environnement et la santé des agriculteurs. Le choix des matières premières est donc essentiel, les matières synthétiques par exemple comme le nylon ou le polyester proviennent essentiellement de composés chimiques provenant du pétrole, source d’énergie fossile très polluante. 70 % des fibres synthétiques produites dans le monde proviennent du pétrole.
L’étape de la fabrication est aussi cruciale puisque des transformations comme la teinture du vêtement nécessitent de nombreux produits chimiques et toxiques et beaucoup d’eau. La production textile est donc responsable d’environ 20 % de la pollution mondiale d’eau potable, à cause des teintures et autres produits de finition. Ces différentes étapes consomment ainsi beaucoup d’eau et d’énergie et en parallèle participent à polluer l’eau et les sols par l’utilisation de produits chimiques.

Que se passe-t-il quand on lave un vêtement ?
La consommation d’eau suite aux lessives de vêtements n’est pas le seul effet nocif, en effet, la majorité des microplastiques de textiles sont libérés lors des lavages réalisés dans les ménages puis la majorité est rejetée dans les eaux usées. Une seule lessive de vêtements en polyester peut libérer 700 000 fibres microplastiques, qui peuvent ensuite se retrouver dans la chaîne alimentaire. Ces microplastiques sont ainsi dû aux fibres synthétiques telles que le polyester ou le nylon qui composent en majorité les textiles synthétiques. Ainsi, en France à compter du 1er janvier 2025 la loi AGEC (Anti-Gaspillage et Économie Circulaire) va rendre obligatoire l’intégration de filtres à microplastiques sur tous les lave-linges neufs commercialisés .
Par ailleurs, la mode “jetable” détient des records d’émissions de gaz à effet de serre notamment en raison de l’externalisation des étapes de fabrication et de production par les firmes multinationales. Prenons l’exemple d’un jean, celui-ci parcourt de nombreux kilomètres passant du champ de coton en Inde à l’atelier de tissage, teinture et filage de la Turquie ou de la Chine et enfin à la confection au Bangladesh, Asie du Sud-Est, Tunisie ou Turquie avant d’être vendu partout dans le monde. Ainsi, la fabrication et la production des produits représentent les 4 milliards de tonnes de gaz à effet de serre générés par l’industrie textile.
Cette mode jetable tient notamment son nom des dangers de l’hyperconsommation et du gaspillage de vêtements. En effet, moins de 1% des matières utilisées pour produire nos vêtements sont véritablement recyclés en nouveaux articles de mode. La fast-fashion a des conséquences sur nos modes de consommation, proposant des produits à bas coûts nous poussant alors à acheter au-delà de nos besoins . L’Oxfam le souligne, en moyenne, 70% des vêtements qui se trouvent dans notre vestiaire ne sont pas portés. L’incinération d’invendus par les marques de mode pour éviter les coûts onéreux contribue fortement à ce gaspillage.
Les dérives de l’industrie textile sur les droits humains.
L’industrie textile pose plusieurs problèmes éthiques en renforçant notamment les inégalités socio-économiques à travers le monde. La fast-fashion y participe activement en raison des multinationales qui en voulant renforcer leur rentabilité externalisent leur production et sous-traitent . Le secteur de la mode emploie 75 millions de personnes à travers le monde cependant les conditions de travail sont la plupart du temps précaires.
L’industrie de la fast-fashion est en effet accusée de dérives mettant en péril les droits humains à la lumière de plusieurs scandales et drames révélant des conditions de travail désastreuses. Suite à un reportage au Pakistan, la célèbre marque de chaussures Nike avait été accusée en 1996 de faire travailler des enfants dans ses usines. L’indignation provoquée par ces “sweatshops” ou “ateliers de misère” bat tous les records lorsqu’un drame survient en 2013. En effet, l’effondrement du Rana Plaza, un atelier de fortune au Bangladesh, a provoqué la mort de plusieurs milliers d’ouvriers travaillant pour des grands distributeurs de vêtements occidentaux. Il aura fallu ce drame pour provoquer une prise de conscience collective sur les dérives de la mondialisation.

Les femmes sont les premières victimes de ce système puisqu’elles représentent 80 % des 75 millions de travailleurs dans l’industrie textile selon Oxfam. Ainsi, les multinationales externalisent leur production, principalement en Asie-Pacifique, profitant d’une main d’œuvre moins onéreuse ainsi que des faibles représentations syndicales et réglementations sur l’usage de certains produits chimiques.
Certains pays d’Asie souffrent particulièrement de cette spirale infernale de rentabilité toujours plus accrue en échange de salaires indécents. En effet, dans la plupart des pays d’Asie où se situe la production textile (Bangladesh, Vietnam, Indonésie, Cambodge et Inde), le salaire minimum est inférieur à 1$ de l’heure (rapport What she makes Oxfam)
L’empire de la fast fashion est accusé par des Organisations de défense de droits humains d’esclavage moderne. En effet, un rapport des Nations Unis datant du 31 août 2022 accusant le gouvernement chinois de violations des droits de l’Homme dans la région du Xinjiang et notamment de persécutions et déportations envers la minorité ouïghoure. La région du Xinjiang est notamment connue pour ses champs de coton où est produit 85% du coton chinois. Certaines multinationales européennes telles que Zara ou encore Nike profitent de ce travail forcé pour renforcer leur profit. Plusieurs études occidentales basées sur l’analyse de documents officiels, les témoignages de victimes présumées et des extrapolations statistiques, affirment que Pékin aurait interné au moins un million de personnes, principalement des Ouïghours, dans des camps.
Malheureusement, dans l’industrie du textile les violations de droits humains à travers le travail forcé ou le travail des enfants est répandu et s’assimile à de l’esclavage moderne. En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé, 15% des enfants âgés de 6 à 14 ans issus des bidonvilles de Dakha, au Bangladesh, exercent un travail à temps plein dans l’industrie textile.
Que faire pour “révolutionner son dressing” ?
La fast fashion a envahit nos dressings et nous pousse à toujours plus acheter, consommer et … jeter. Selon l’Ademe, une personne achète 40% de vêtements en plus qu’il y a 15 ans et les conserve deux fois moins longtemps, ce qui a de nombreuses conséquences sur notre planète.
En clair, on achète toujours plus sans forcément toujours regarder ce qu’on possède déjà dans nos armoires. L’essor rapide des plateformes de vêtements en ligne notamment chinoise comme Temu ou Shein qui proposent des produits à bas coûts grâce à une hyperproduction y jouent un rôle clé.
En 2023, après une analyse du site de la marque durant le mois de mai 2023 les Amis de la Terre ont conclu que Shein a ajouté sur son site plus de 7 200 nouveaux modèles de vêtements par jour en moyenne, atteignant parfois 10 800 nouveaux modèles dans la journée. En fait, le consommateur est comme assommé par cette offre toujours plus intense de vêtements à bas coût, produits par des méthodes frauduleuses de rentabilité à tout prix.
Le principe de la mode “jetable” c’est donc de pousser le client à acheter toujours plus non par besoin mais par envie d’acquérir de nouvelles pièces. En effet, les vêtements les moins coûteux, vendus par les enseignes de fast-fashion, ne sont portés que 7 à 8 fois en moyenne. Ainsi, l’obsolescence des vêtements ne se traduit plus par l’usure physique mais plutôt pour des critères esthétiques.
Avec l’équipe Greenfluence, nous avons eu la chance d’assister à une conférence animée par Thibault Liebenguth, consultant en stratégie d’impact et éco-conception pour l’entreprise Air Coop sur l’industrie textile à Sciences Po Rennes.

1
Un design sobre et intemporel
Thibault a notamment mis en lumière les renouvellements toujours plus rapides des collections de marques considérées comme appartenant à la fast fashion. En effet, Shein propose en moyenne 900 fois plus de produits qu’une enseigne française traditionnelle. Shein et Temu, les plateformes chinoises de vente en ligne connaissent un succès phénoménal chez les consommateurs puisqu’elles représentent 22% des colis envoyés par la poste alors qu’ils pesaient “moins de 5% il y a cinq ans” selon le PDG. C’est pourquoi, T.Liebenguth préconise une réduction de notre consommation pour permettre aux entreprises de mieux produire. Ce dernier défend ainsi une mode durable qui passerait par des produits aux couleurs sobres, qui auraient une vraie utilité et seraient portés souvent. Consommer chez des marques de vêtements ne renouvelant pas systématiquement leur collections représente un pas en avant vers la mode éthique.
2
Des matériaux renouvelables
T. Liebenguth souligne par ailleurs l’impact environnemental de la fabrication du tissu et insiste sur l’importance que représente le choix du tissu. Dans son enquête intitulée « Crimes de mode. Les géants européens liés au scandale du coton brésilien », publiée le jeudi 11 avril, l’organisation britannique Earthsight critique les dérives de la culture intensive du coton brésilien. Cette matière première, surnommée “or blanc”, est exportée vers l’Asie pour produire les jeans de grandes marques comme Inditex, propriétaire de Zara et leader mondial de l’habillement, ainsi que H&M.
Contrairement au coton conventionnel, dont la culture est gourmande en eau et en pesticides, le coton biologique offre une solution plus respectueuse de l’environnement. Cultivé sans produits chimiques de synthèse, il contribue à préserver la biodiversité et la santé des sols. De plus, les conditions de travail des agriculteurs sont souvent meilleures dans les chaînes de production certifiées bio.
La marque Veja, pionnière en matière de baskets écologiques, intègre l’huile de ricin dans la fabrication de certains de ses modèles. Issue de la plante de ricin, cette matière renouvelable est utilisée pour concevoir des semelles légères et résistantes.
La laine, en plus d’être une ressource renouvelable, a un bilan environnemental intéressant. Les moutons, en broutant l’herbe, participent au maintien des prairies, qui agissent comme des puits de carbone en captant le CO2 atmosphérique. De plus, la laine est biodégradable et peut être recyclée, ce qui réduit les déchets textiles. Cependant, pour maximiser ses avantages écologiques, il est essentiel de privilégier des élevages responsables qui respectent le bien-être animal et les écosystèmes locaux.
La marque “Owl” illustre une approche novatrice du design textile avec ses vestes transformables en pochettes. Ce concept incarne une tendance vers des produits multifonctionnels, réduisant ainsi la nécessité d’acheter plusieurs articles. Fabriquées à partir de matériaux renouvelables, ces vestes mettent en avant l’idée que la mode peut être à la fois pratique, esthétique et respectueuse de l’environnement.
3
Une énergie décarbonée
L’industrie textile est l’une des plus polluantes au monde, et son impact environnemental est directement lié à la manière dont elle utilise l’énergie tout au long de la chaîne de production. De la fabrication des matières premières à la production des vêtements, la transition vers une énergie décarbonée est un levier essentiel pour réduire son empreinte carbone.
L’adoption d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique) dans les processus de fabrication est l’une des solutions clé pour décarboner l’industrie textile. Aujourd’hui, la majorité des usines textiles sont situées dans des pays où l’électricité provient principalement de centrales à charbon ou à gaz, comme la Chine, l’Inde ou le Bangladesh.
Près de 70 % des émissions de gaz à effet de serre de l’industrie textile proviennent des opérations en amont de la chaîne de valeur ( matières premières, transformation et traitements). Ces étapes nécessitent souvent des processus énergivores (chauffage, pressage, séchage), réalisés dans des usines fonctionnant avec des énergies carbonées.
Ainsi, la localisation géographique des usines textiles a un impact significatif sur leur empreinte écologique. Par exemple, la Chine, leader mondial de la fabrication textile, produit une grande partie de son électricité à partir de charbon, une source d’énergie particulièrement polluante.
Certaines industries montrent qu’il est possible de conjuguer production industrielle et énergie verte. Par exemple, certains fabricants de skis en Autriche utilisent exclusivement de l’électricité issue de sources renouvelables (hydroélectricité, solaire, éolien).
4
Production transparente et Relocalisée
L’industrie textile, longtemps délocalisée vers les pays du Sud-Est asiatique pour réduire les coûts, est marquée par des conditions de travail souvent indécentes, avec de graves atteintes aux droits humains, comme l’illustre la tragédie du Rana Plaza en 2013. Face à ces dérives, la relocalisation et la transparence dans la production deviennent essentielles. Des initiatives émergent, comme celles de marques éthiques telles que Loom, qui privilégient des chaînes de fabrication responsables avec comme slogan “Achetons moins, produisons mieux”.
5
Des produits plus durables
Adopter une mode éthique et responsable est à portée de main puisqu’il suffit que l’on garde nos vêtements 9 mois de plus pour réduire leur impact de 20 à 30%. Thibault Liebenguth porte notre regard sur la marque Houdini qui propose la polaire Power Houdi qui est portée en moyenne 1287 fois par les clients et a une durée d’utilisation de plus de 10 ans. De plus, la marque Patagonia propose un système de réparation de leurs produits et s’engage ainsi à lutter contre la surconsommation. De nombreuses initiatives de seconde main ont été mises en place avec la création de la célèbre plateforme Vinted par exemple ou encore les marchés de location de vêtements.
La fast fashion, véritable miroir des excès de notre société de consommation, ne peut plus ignorer les signaux d’alerte qui se multiplient. Entre exploitation des ressources naturelles, conditions de travail indignes et montagnes de déchets textiles, son modèle économique semble à bout de souffle face aux exigences environnementales et sociales du XXIᵉ siècle.
Mais des alternatives émergent : des marques plus responsables, des circuits courts, le recours aux matériaux durables, ou encore la montée en puissance de la seconde main redéfinissent peu à peu les contours de la mode. Il appartient désormais aux consommateurs, aux industriels et aux législateurs de jouer un rôle complémentaire pour accélérer cette transition. Consommer moins, mais mieux, pourrait bien devenir le nouveau mantra d’une industrie en quête de sens. En fin de compte, s’habiller ne devrait plus se faire aux dépens de la planète ni des travailleurs qui la font vivre.
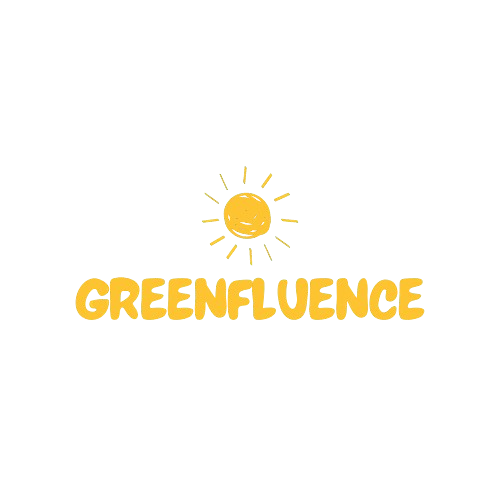






Merci Anaïs pour ce super article qui nous fait réfléchir à notre propre façon de consommer.
Merci beaucoup Anaïs pour cet article plein de sens à l’heure de la grande consommation.
Super article qui m’a fait ouvrir les yeux sur la fast fashion ! 🙀🎀
Article de grande qualité qui pousse à réfléchir intelligemment sur sa manière de consommer
Très pertinent quand on observe notre façon de consommer dans la société, et le changement des mentalités compliqué à modifier…