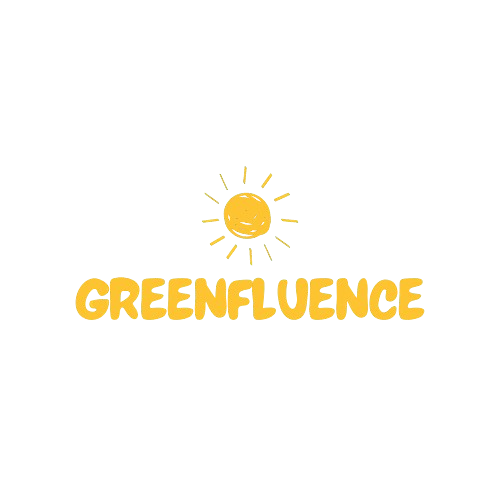C’est sûrement l’un des accords les plus anciens mené par l’Union européenne. Après vingt-cinq ans de négociation, la Présidente de la Commission européenne a conclu le 6 décembre 2024 les négociations du traité avec les chefs d’Etat de quatre pays du Mercosur. Malgré sa signature, l’accord est loin de faire l’unanimité entre les chefs d’État, au Parlement et au sein de la société civile. L’Union européenne de 2024 a été traversée par la crise de la Covid-19, une augmentation de la dette sans précédent, le retour de la guerre sur son territoire et doit se préparer à faire face à la crise écologique. Les promesses autour d’une mondialisation heureuse et d’un libéralisme gagnant-gagnant sont source de vives tensions. L’accord devrait être soumis à la ratification du Conseil européen puis au vote du Parlement européen au cours de l’année 2025. Pourquoi l’accord UE-Mercosur divise-t-il autant ?
Au cœur de la géopolitique de l’Accord : retour sur 25 années de négociation.
L’ampleur du projet de l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Mercosur est indéniable. Ce bloc économique concentrerait un cinquième de l’économie mondiale et accueillerait plus de 750 millions de consommateurs. Il concerne les 27 États membres de l’Union européenne ainsi que les membres du “marché commun du Sud” ou Mercosur regroupant cinq pays d’Amérique du Sud dont l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et la Bolivie. Le nombre de pays concernés explique en partie la complexité des négociations ainsi que les rivalités sous-jacentes. On décompte aujourd’hui 38 cycles de négociations.
Les origines des négociations reposent sur l’accord d’association entre l’UE et le Mercosur de 1999 ayant deux objectifs : le développement des relations commerciales et la promotion de la coopération et du dialogue politique entre les deux parties. Depuis cette date, l’Accord a été marqué par des élans et des interruptions. Les négociations ont cependant été radicalement suspendues en 2019 compte tenu des critiques de la France et de l’Allemagne à l’égard de leur homologue brésilien Jair Bolsonaro. Alors que la forêt amazonienne connaît d’immenses incendies au cours de l’année, le 23 août 2019, Emmanuel Macron hausse le ton. “Le président Bolsonaro a décidé de ne pas respecter ses engagements climatiques ni de s’engager en matière de biodiversité” estime Emmanuel Macron qui affirme que “Dans ces conditions, la France s’oppose à l’accord Mercosur en l’état”. Cet accord commercial est fortement dépendant des dynamiques géopolitiques surtout depuis la montée de figures politiques ouvertement climatosceptiques. Les négociations ont été également gelées dans le contexte de pandémie mondiale de la Covid-19 en 2019 et 2020. La soudaine reprise des négociations est due principalement à l’arrivée de Lula da Silva, tête du Parti des travailleurs au pouvoir en 2023. C’est dans ce contexte que des négociateurs de la Commission européenne se sont rendus deux fois au Brésil, au début des mois de septembre et d’octobre 2024. Ursula von der Leyen, très attachée à l’aboutissement de ces négociations a également été réélue à la tête de la Commission européenne le 18 juillet 2024 avec deux objectifs pour l’Union : “Autonomie stratégique ouverte et compétitivité durable”. Elle a notamment déclaré lors de la signature de l’Accord “Nous avons conclu les négociations pour l’accord UE-Mercosur. C’est le début d’une nouvelle histoire. Je m’en réjouis maintenant d’en discuter avec les pays européens”.
Bien que les les chefs d’États du Mercosur aient signé avec Ursula von der Leyen, les tensions se concentrent désormais au sein de l’Union européenne. En France, lors d’un vote à l’Assemblée nationale et au sénat en novembre dernier, le vote contre l’Accord l’a largement emporté. L’accord divise également en Autriche, en Italie et aux Pays-Bas alors que l’Allemagne et l’Espagne y semblent plus favorables. Bien que l’Accord ait été signé, sa ratification ne sera pas sans embûches.
Brièvement, en quoi consiste l’Accord ?
Le volet commercial de l’Accord UE-Mercosur est le plus médiatisé car c’est lui qui engendre les principales inquiétudes quant à ses conséquences économiques, sociales, sanitaires et environnementales. Deux autres volets de cet accord sont moins connus. Les deux premiers concernent le dialogue politique et la coopération. La Commission européenne, sur son site officiel affirme qu’ “À un moment où les pressions protectionnistes s’accroissent, un accord de partenariat entre l’Union européenne et le Mercosur envoie un signal clair au monde que ces deux économies majeures : rejettent le protectionnisme et sont ouvertes au commerce et à l’échange sur des bases de règles justes et de standards élevés”. Le troisième volet concerne le commerce.
Le volet commercial de l’accord suscite de nombreuses tensions au sein de l’Union européenne. Il prévoit la libéralisation de plus de 90% des échanges commerciaux entre les deux blocs qui représentent environ le quart du Produit intérieur brut mondial, comme le rappelle l’ONG belge CNCD 11.11.11. En rapport avec les principales marchandises concernées, l’accord est souvent résumé sous le terme de “bœufs contre voitures”. En effet, le marché européen s’ouvrirait aux produits agro-alimentaires sud-américains en particulier les exportations de bœuf ainsi qu’aux produits issus des industries extractives. L’UE est le second marché pour les exportations de ressources minières du bloc sud-américain. Du côté du Mercosur, les droits de douane seraient progressivement éliminés sur les voitures, les machines, la chimie, les vêtements, le vin, les fruits frais ou encore les chocolats. Cet accord vise donc à ouvrir l’industrie manufacturière européenne et en particulier le secteur automobile.
Les conséquences en termes de libre-échange sont donc considérables. Pour Olaf Scholz, chancelier Allemand cet accord représente “un libre marché, plus de croissance et de compétitivité pour plus de 700 millions de personnes”. Cet accord augmenterait indéniablement les échanges commerciaux. Considérant seulement le Mercosur, il concentre 82,3% des richesses produites en Amérique du Sud. C’est le quatrième bloc économique en termes de libre-échange au monde. Il est évident que cet accord ferait de la zone de libre-échange UE-Mercosur un des plus grands marchés au monde produisant un quart du PIB mondial.
Certaines industries sortiront gagnantes de cet accord. C’est le cas des grandes firmes de viande et de volaille bovine sud-américaines telles que JBS, Marfrig et Minerva qui fournissent déjà le marché européen. L’industrie des pesticides, déjà puissante, va pouvoir également accroître ses parts de marché. En Union européenne, les grands gagnants de cet accord sont les grandes firmes automobiles y compris françaises qui pourront profiter de l’ouverture des marchés pour exporter vers le Mercosur. Les avantages économiques de cet accord sont difficiles à évaluer et certaines analyses ne prévoient pas un grand sursaut économique tel qu’il est parfois évoqué. Une analyse d’impact réalisée par la London School of Economics pour la Commission européenne évalue les gains économiques de 10 à 15 milliards d’euros, soit 0,1% du PIB européen. Il est évident que cet accord renforcera le poids du marché en abaissant les recettes des États. L’article 8 du chapitre sur le commerce des marchandises stipule que, trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, aucune des parties ne pourra introduire ou maintenir ces droits ou taxes à l’exportation. Pour l’année 2019, l’État argentin a perçu 4,7 milliards de dollars sur les droits à l’exportation du soja. C’est pour cette raison que le pays s’est réservé le droit de prélever des droits à l’exportation. Selon les défenseurs de cet accord, il bénéficiera à 60 000 européenne dont 30 000 PME, avec des économies estimées à 4 milliards d’euros en tarif. L’accord UE-Mercosur profitera à certains secteurs et confortera leur pouvoir sur le marché ainsi que sur les instances européennes. Ce qui est sûr, c’est que cet accord soutient une ligne politique de libéralisation du marché européen.
Du libre-échange au détriment de l’écologie.
Dès le jour de l’annonce d’un nouvel accord le 6 décembre 2024, Greenpeace France le qualifie de “bombe environnementale et sociale”. Déjà en 2019, à la fin des négociations politiques, Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme et professeur de droit international affirmait “L’accord UE-Mercosur va conduire à échanger des voitures contre de la viande sur l’Atlantique. Il est une insulte à tous les jeunes qui ont marché pour le climat et aux défendeurs des droits de l’homme et de l’environnement au Brésil. Le Parlement européen doit mettre son veto. Nous exigeons de la cohérence entre le commerce et les valeurs que l’UE prétend porter”. Il convient évidemment de rappeler que cette séquence se situait au moment de la mise en place de politiques climatosceptiques et anti-sociales par Jair Bolsonaro. Cependant, la plupart des ONG environnementales continuent de s’opposer fermement en 2024 à tout nouvel accord.
Il est indéniable que la libéralisation des échanges est source de questionnement sur le plan environnemental. À l’échelle mondiale, les échanges commerciaux sont à la source de plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Cette ouverture sur le marché du Mercosur accroîtra les échanges entre les deux blocs. L’Union européenne est une puissance normative importante. Les normes environnementales sont plus ambitieuses dans l’Union qu’autre part dans le monde. Les objectifs politiques de l’Union sont également ambitieux dont le Green Deal qui vise la neutralité 2050. L’Union pourra-t-elle répondre à ses ambitions en ouvrant son marché à d’autres blocs économiques ? Si l’on regarde seulement le secteur de l’alimentation, l’Union mène des stratégies telle que “De la ferme à la table” qui promeut une alimentation plus saine et plus durable. Elle vise à faire évoluer le système alimentaire actuel de l’Union européenne de l’UE vers un modèle durable selon les termes de la Commission. En parallèle, certaines ONG mettent en avant le fait que cet accord rendra plus opaque la chaîne d’approvisionnement tout au long de la chaîne alimentaire. L’accord ne va-t-il pas à l’encontre de ses objectifs ?

Sur de nombreux plans, l’accord UE-Mercosur rend complexe la réalisation de ces objectifs de transition écologiques. Concernant la lutte contre la déforestation, l’accord est très questionnable. D’autant plus que le Parlement européen a voté le 17 décembre dernier le report d’une loi anti-déforestation. Le pression sur le poumon vert en Amérique du Sud est déjà forte. L’accord soutiendra l’exportation de soja depuis le Mercosur. Déjà aujourd’hui, plus de 13 millions d’hectares, soit l’équivalent de la superficie de l’Allemagne sont mobilisés pour l’exportation de soja vers l’Union européenne. La situation est encore plus alarmante lorsque l’on regarde la production de viande. 70% des incendies de 2019 se sont déclarés dans des régions de provenance du bétail abattu par les trois plus grandes firmes de production bovine brésiliennes.
Dans un contexte de transition écologique, la régulation des marchés s’impose afin de mieux contrôler la chaîne de production des produits. L’accord UE-Mercosur intègre insuffisamment le principe de précaution afin de protéger ses consommateurs et la planète. Ce principe est défini dans les textes européens comme “une approche de la gestion du risque qui prévoit que, si une politique ou une mesure présente un risque potentiel pour la population ou l’environnement et qu’il n’existe pas de consensus scientifique sur la question, cette politique ou cette mesure ne devrait pas être poursuivie.” Le chapitre sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ne mentionne pas une seule fois le principe de précaution. Les règles au sein du marché Mercosur ne sont pas aussi exigeantes qu’en Union européenne. Selon un rapport de Greenpeace datant de 2020, sur les 500 pesticides dont l’utilisation était autorisée au Brésil en 2017, 30% étaient interdits dans l’UE. La crise agricole depuis 2022 démontre déjà assez la complexité de mise en place des normes environnementales ambitieuses dans le seul cadre de l’Union. Le Green Deal vise à réduire de 50% l’usage des pesticides dans l’Union européenne à l’horizon 2050. Comment envisager cette réduction si les pays du Mercosur peuvent réagir en imposant des sanctions commerciales envers une Union qui déciderait d’abaisser les seuils autorisés de pesticides ? Les mécanismes de mesures miroirs pourraient permettre aux pays du Mercosur de faire obstacle à la mise en place de politiques environnementales ce qui pourrait entraîner un gel réglementaire. Alors que l’UE vise à la transparence de son système alimentaire en promouvant des pratiques durables, elle ne pourra entièrement contrôler la chaîne de production au sein du Mercosur.
L’élément qui cristallise les voix des ONG environnementales concerne l’exclusion du chapitre “Commerce et développement durable” du système bilatéral de règlement des différends commerciaux. Autrement dit, cette exclusion ne rend pas les dispositions environnementales juridiquement contraignantes. Elles seront seulement résolues par des groupes d’experts sous forme de simples recommandations.
Quelles sont les principales oppositions ?
Outre les grands acteurs conventionnels classiques tels que les ONG, d’autres acteurs européens sont impliqués dans le débat autour de l’accord UE-Mercosur. C’est évidemment le cas des agriculteurs dont les mouvements ont parcouru toute l’Union. Ils seront soumis à une concurrence face au Brésil et l’Argentine qui sont des puissances agricoles majeures. Depuis la crise de la Covid-19 ainsi que la crise ukrainienne, le pouvoir d’achat des Européens baisse et de plus en plus de consommateurs achètent au prix le plus bas. Il est évident que les produits du Mercosur seront très compétitifs sur le marché alors qu’ils ne respectent pas les mêmes normes environnementales. Les dispositions juridiques autour de la nécessité d’avoir des systèmes d’alimentation durable tels qu’elles sont présentes dans des accords bilatéraux avec la Nouvelle-Zélande ou le Chili sont absents dans le texte UE-Mercosur. Or, selon le rapport stratégique de l’UE sur l’agriculture datant de 2024, l’Union vise à “la transition agricole européenne conçue de manière à mettre en place des systèmes plus résilients, plus durables, plus compétitifs, plus rentables, plus justes”.
Les autorités sanitaires se disent également inquiètes. En 2019, une équipe de journalistes révèle que 20% de la viande de volaille importée du Brésil était contaminée à la salmonelle. Des clauses contraignantes en matière de responsabilité des entreprises tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont absentes des textes. Au sein de l’Union européenne seule la France est dotée d’une loi complète relative aux chaînes d’approvisionnement (Loi sur le devoir de vigilance).

Dans le cadre des droits de l’Homme, l’accord divise également. Le sort des populations autochtones en Amérique du Sud fait débat. L’article 8 du chapitre sur le développement durable prévoit de promouvoir l’inclusion des communautés locales et des peuples indigènes dans les chaînes d’approvisionnement et des produits forestiers. Cependant, contrairement à l’accord avec la Nouvelle-Zélande, aucune disposition ne permet de tenir compte de la voix des populations locales consacrée par les Nations Unies. De plus, le droit des populations autochtones dépend fortement des orientations politiques locales. Peu après son élection, Bolsonaro avait interrompu les procédures de délimitation des peuples autochtones.
Les évolutions de l'accord : vers la signature en 2024 ?
Selon la Commission européenne en décembre 2024, sur le nouvel accord, il y a ““des engagements clairs et exécutoires en matière de développement durable, y compris en ce qui concerne les droits des travailleurs et la gestion et la conservation durables des forêts”. Cependant, l’ONG belge CNCD 11.11.11 rappelle que “La nouvelle annexe sur le développement durable est exclue de tout recours à des sanctions”. Cette coopération est avant tout politique et n’engagera que la consultation d’experts sur ces questions.

Le grand changement dont parle la Commission réside dans la mention de l’Accord de Paris bien repris dans l’accord finalisé sous forme de clause essentielle. Une nouvelle fois CNCD 11.11.11 met en avant le caractère politique d’une telle clause “Une clause essentielle n’est pas une sanction, seulement un outil de dissuasion”. Il est évident que l’élection récente du président argentin Javier Milei très réticents aux processus onusiens doit envisager l’avenir de cet accord en cas de retrait de l’Argentine des Accords de Paris.
Concernant la suite de l’application de l’accord, les regards se tournent essentiellement sur le Conseil européen qui se tiendra normalement courant 2025. Le rejet de cet accord ne sera effectif que si 4 pays représentant 35% de la population européenne votent contre sa signature. En l’état, la France, la Pologne, les Pays-Bas et l’Irlande semblent plus en défaveur de l’accord. Ces pays ne comptent que pour 28,62% de la population européenne. Un pays qui pourrait se retrouver au cœur des discussions serait l’Italie qui compte à elle seule 13,25% de la population européenne. De simples scénarios et tensions demeureront jusqu’aux votes respectifs du Conseil européen et du Parlement.